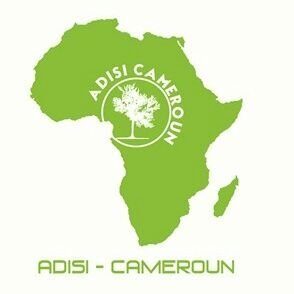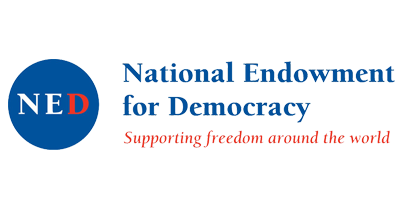Dépigmentation : Des produits de plus de 104 millions F Cfa saisis en 2022

Les produits de Dépigmentation au Cameroun
Ces prises ont été effectuées dans 4 régions du Cameroun. Avec un marché qui croît de 7% par an, le secteur cosmétique est dominé par la vente illicite des produits blanchissants, qui handicapent la lutte contre la dépigmentation au Cameroun.
Olive Mebenga, 28 ans, ne jure plus que par sa nouvelle peau « blanche » acquise à coût de centaines de milliers de F Cfa. Un investissement qui ne semble pas gêner la dame car pour elle, c’est le résultat qui compte. « Mon père a eu des enfants avec une Européenne. Étant la seule à avoir une peau foncée, j’ai décidé de m’arranger pour ressembler aux autres », confie Olive, toute joyeuse. Comme elle, Honorine s’est dépigmentée la peau, mais pas pour les mêmes raisons. « Mon mariage a battu de l’aile il y a trois ans à cause de ma couleur ébène. J’ai été obligée de me décaper pour correspondre aux critères de mon homme », souffle cette trentenaire.
Elles sont nombreuses à s’éclaircir volontairement la peau à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Une pratique que le Pr Anne Cécile Zoung-Kanyi Bissek, présidente de la Société camerounaise de dermatologie-vénérologie, assimile à des souffrances psychologiques telles : « qu’un changement de personnalité associé à la métamorphose physique induite. » Selon elle, l’ampleur du phénomène sur le plan local n’est pas bien connue . Cependant, il semble en plein essor au vu de l’arsenal qui jonche les étagères des commerces et des instituts de beauté.
Une enquête menée en 2015 par le Pr Armand Kouotou, médecin dermatologue-vénérologue auprès des commerçantes dans 5 marchés de Yaoundé a permis de situer sa prévalence à 43,6 %. Pour justifier cela, Eunice Kamga, propriétaire d’un « laboratoire » témoigne de la forte demande de ces produits. « 8 sur 10 de nos clientes ne réclament que les produits blanchissants. Nous sommes obligés de nous arrimer à cette forte demande pour ne pas perdre la clientèle », confesse cette coiffeuse reconvertie dans la fabrication des « cosmétiques blanchissants ».
Interdiction
La montée en puissance de la fabrication de ces produits a poussé Manaouda Malachie, ministre de la Santé publique (Minsanté) à publier le 30 mars 2023, une liste non exhaustive de 328 produits cosmétiques et d’hygiène corporelle dangereux. Une sortie qui a suivi celle d’août 2022 qui interdisait l’importation, la fabrication et la distribution de certaines substances éclaircissantes contenant de l’hydroquinone et ses dérivés, le mercure et ses dérivés sans oublier les corticoïdes. Le Minsanté a, en effet, saisi en septembre 2022, dans les régions du Centre, Est, Ouest et Littoral des produits d’une valeur de 104 245 400 millions F Cfa, a indiqué Dr Solange Kouakap, l’inspectrice générale des services pharmaceutiques et des laboratoires au Minsanté.
Selon Dr Alain Patrice Meledie, dermatologue, l’usage de ces produits dangereux prédispose à plusieurs maladies comme les cancers, l’obésité, l’hypertension artérielle et l’insuffisance rénale. Malgré l’interdiction de la commercialisation des produits décapants, un marché noir s’y est développé, notamment sur internet. Dr Alain Patrice Meledie explique cela par des intérêts économiques que génère ce secteur, même si les données nationales sur leurs parts de marché sont méconnues.
Marché noir
L’Institut national de la statistique (Ins) indiquait en 2020 que le marché des cosmétiques en général était en croissance annuelle de 7% et avait atteint 380 milliards F Cfa au Cameroun. L’Association nationale des promoteurs des produits cosmétiques (Anaproc) affirme que localement, les cosmétiques raflent aujourd’hui près de 65% des parts de marché national. Entre 2015 et 2017, les produits importés représentaient pratiquement 75% des parts de marché, contre 25% pour les produits locaux dont 360 marques référencées. La situation s’est inversée depuis lors .
A côté de ces intérêts économiques, ce marché noir serait aussi, selon le président de l’Anaproc, entretenu par l’Etat car dit-il, ce n’est pas à lui de déterminer le produit de contrefaçon. Mais,« c’est l’opérateur économique qui maîtrise le circuit de distribution de son produit qui enquête, qui peut engager un procès de contrefaçon en justice. » L’Accord de Bangui qui institue l’Oapi relève-t-il, indexe le titulaire de marque comme étant celui qui protège son circuit commercial.
Conformité
A côté de cela, les fabricants des cosmétiques, accusent toutes les tracasseries qui entourent désormais la validation d’un produit. « Or, en 2005, le Minsanté a signé un arrêté demandant que tous les produits cosmétiques fabriqués au Cameroun ou importés fassent l’objet d’un bulletin d’analyse au Lanacome qui coûtait 280.000 F Cfa. La procédure était très courte. Aujourd’hui, le Minsanté et l’Anor s’en mêlent et du coup l’opérateur économique est perdant », dénonce le président de l’Anaproc.
Désormais, le fabricant est astreint à l’obtention d’une attestation d’installation délivrée par le Minsanté et le certificat de conformité obtenu auprès de l’Anor. Deux documents qui reviennent à plusieurs millions F Cfa en fonction de la quantité des produits. « Le Minsanté et l’Anor doivent s’accorder », laisse entendre le président de l’Anaproc qui soupçonne une guerre de leadership entre les deux institutions.
Brouille
On a en mémoire, la récente liste des produits dits dangereux publiée par le Minsanté dans laquelle les produits des Laboratoires Carimo, sont cités et pourtant ils détiennent un certificat de conformité comme on peut le voir sur le site internet de l’Anor. Une certification dont la validité court jusqu’au 31 décembre 2023.
Mélanie Ambombo